Tableau des musemes
|
Musème 1 :
« l’interpellation »
Interpellation 1
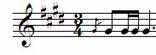
|
Interpellation 2
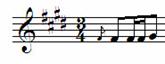
|
Interpellation 3 
|
|
Musème 2 : le
« parlé-chanté »
Parlé-Chanté Vocal 1

Parlé-Chanté Vocal 2

|
Parle-chanté Instrumental 1
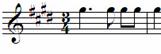
Parlé-chanté Instrumental 2

|
|
Musème 3 :
« exténuation »
Appogiature vocale 1

|
Appogiature vocale 2

|
Appogiature vocale 3

|
|
Musème 4 :
« Malaise »
Chromatisme Instrumental

Chromatisme Instrumental 2

Chromatisme Vocal

|
Musème 5 : « la plainte »
Plainte instrumentale 1
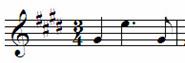
|
|
Musème 6 : « la
désignation »

|
|
Musème 7 : « la
tempête »
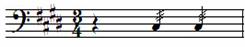
|
Les Musemes
-La voix-
Tout au long du morceau le chant est
posé de façon syllabique. Aucun mélisme n’ornemente la ligne mélodique, les
paroles sont mises en valeur et facilement intelligibles. Le chant épuré de
toutes fioritures est revendicateur et peut transmettre aisément son message.
Cette écriture
vient renforcer le sens du texte et son caractère décharné, le thème de la mort
et le sentiment exaspéré et désillusionné du chanteur est appuyé par cette
simplicité et l’ambiance étroite et stagnante de la mélodie, dont l’ambitus est
généralement restreint (excepté dans le refrain) qui ne dépasse pas l’octave.

Le couplet est construit sur deux phrases
mélodiques et harmoniques. Premièrement, le chant est structuré à partir d’un antécédent
et d’un conséquent, il est soutenu par l’harmonie qui apporte une alternance
entre détente- tension- détente suivant le schéma I – II – V – I degrés.
Mus. 2 « « l’exténuation »
1) 2)
2) 3)
3) 
Le chant étant
principalement monodique, les paroles sont récitées sur une corde qui descend
en fin de phrase sur la seconde majeure inférieure. La descente est renforcée
par un effet de glissando. Celle-ci est amenée par une appogiature qui vient
intensifier et appuyer la fin de chaque phrase. Procédé que nous retrouvons
dans de nombreuses œuvres. Nous citons au passage :
Comme d’habitude de J. Revaux et G. Thibaut (1967)

Charles Aznavour Comme ils disent (1973)
 Mozart
Fantaisie en ré mineur K.V.397
Mozart
Fantaisie en ré mineur K.V.397

Quant au passage
monodique cela n’est pas sans rappeler le style chanté-parlé des récitatifs que
nous retrouvons dans la musique d’opéra, les cantates dont la fonction est de
faire évoluer l’intrigue et de déclamer le texte. Ce style est utilisé
également dans de nombreuse musique populaire, où le rythme a une place
prépondérante, (rap, reggae...)
Mus. 1 « l’interpellation »
1)  2)
2)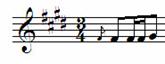 3)
3)
Cette monotonie est
rompue par le rythme saccadé au début de chaque phrase, dont la dynamique
interpelle l’auditeur et accentue le caractère revendicateur de la chanson.
Ce procédé se retrouve dans de nombreuses
musiques engagées, rock, rap, provocant un côté agressif évoquant la lutte et
combat, à l’instar de :
Fela Kuti, Government
Chicken Boy

Michael Jackson They dont care about us

Guns n’roses You could by mine

L’antécédent et le conséquent sont
donc construits sur trois musèmes :
le rythme saccadé – la récitation monodique – l’appogiature en fin de phrase,
dont les valeurs complémentaires construisent un discours logique et
organisé : Interpellation – Parlé- chanté (explication) – Exténuation (abandon).
Ces trois musèmes sont renforcés par
le timbre rauque, peu intense et abîmé
du chanteur.
La mélancolie et la lassitude sont
marquées par la descente immuable de la mélodie chantée et qui sont renforcées
à chaque fin de phrase par l’appogiature. De plus, nous retrouvons dans la
partie chantée le chromatisme descendant [notes rouges] de l’orgue de barbarie,
qui accentue l’ambiance sombre.
Mus. 6
« la désignation »

Le refrain contraste avec les
couplets. Tout d’abord il commence en Majeur, dans la tonalité de mi, le
relatif, puis revient en do# mineur. La ligne du chant, plus
« lyrique » que dans le couplet, est élargie par un saut de 4te Juste
ascendante. Cet intervalle enrichit la ligne mélodique et lui dessine un
contour plus ample. Elle transmet un mouvement d’élancement et de balancement
qui met en relief les mots Vieux et Attentat. Ceux-ci peuvent être mis en
relation avec les mots Ambassade,
Grabataire, Militaire, Tortionnaire et
Ministère qui sont accentués par un léger mouvement ascendant de seconde
majeure. Cela conditionne un système de « bornes auditives » qui
apportent à l’auditeur des rappels mnémotechniques, lui induisant un champ
lexical à connotation négative provoquée par ce système de correspondance
sonore.
-Les cordes-
Le contraste entre la ligne du chant
au couplet et au refrain est soutenu par l’arrivée des cordes ou 2ème –
3 ème - 4 ème refrain. Celles-ci entraînent un changement de
couleur de par leur timbre feutré. Les violons sont ici un indicateur de style. Leurs jeux assez
classique (tierces parallèles, réexposition du thème, sonorités rondes) rappel
le genre symphonique et les valses viennoises qui peignent un décor de château et
remémore les grands bals qui avaient (ont) lieu dans les milieux aisés. Le beau Danube Bleu, La valse de l’empereur. Cela correspond
avec le sens des paroles Bal à
l’ambassade.
Le refrain fait
ressortir à la fois un monde plutôt mondain par les procédés musicaux de
l’accompagnement que nous venons de décrire et à la fois une critique par le
chant, le texte contestataire qui pointe du doigt ce milieu, cette politique.
- Les timbales -
Mus 7
« la tempête »

Les timbales n’interviennent qu’au
passage du refrain. Elles se font entendre trois fois au cours de celui-ci et
par un jeu de roulement. Leur fonction de marqueur périodique et d’annonce
dramatique est ici très important. En effet pendant que les cordes décrivent un
« univers doré » le roulement des timbales évoque en même temps une
scène de tempête. Elément dramaturgique qui se retrouve notamment dans de
nombreux opéras.
Fernand
Cortes de Spontini – Acte 3 - Scène 6


La Vestale de Spontini Acte 3 – Scène 6



L’effet dramatique de la scène de tempête est
accentué par le fracas des cymbales qui ponctue la fin du roulement. Confère L’apprenti Sorcier de Dukas, Gladiateur, La danse macabre de Saint-Saëns
Mus. 4
« le malaise »

L'orgue de barbarie a un rôle d'accompagnateur. Il s'inscrit dans le rythme de valse, la
basse étant entendue sur le premier temps, et l'harmonie sur le deuxième et
troisième temps.
Dans ce musème, on
peut distinguer deux éléments significatifs, renvoyant chacun à une perspective
culturelle manifeste.
Le premier est directement
lié au timbre de l'orgue de barbarie affecté au rythme de valse et à la configuration
structurelle décrite ci-dessus. Celle-ci évoque la fête foraine, le cirque, le
manège (par le côté cyclique de la structure basse / accord / accord), et par
voie de conséquence, les enfants, ou, tout du moins, l'enfance.
Le second est lié à
l'harmonie opérée. On voit, en rouge, apparaître un chromatisme descendant. Ce
chromatisme est une figure qui peut, dans le cadre d'une tonalité mineure comme
ici, suggérer l'angoisse, la peur, ou, en tout cas, il a pour effet une
certaine puissance dramatique. Cette figure musicale est notamment utilisée
dans la musique de film d'horreur ou des films fantastiques, peuplés de
sorcières et de créatures magiques. Les exemples ci-dessous, contenant ce
procédé, semblent significatifs. Il s'agit d'extraits de la musique du film Halloween,
du film Harry Potter et de la
Danse macabre de Camille Saint-Saens, oeuvre au
titre évocateur.

Musique du film Halloween
de John Carpenter, chromatisme descendant à la basse :

Musique du film Harry Potter,
chromatisme descendant à la deuxième mesure :
Danse macabre, de
Camille Saint-Saens, chromatisme descendant des mesures 50 à 53 :

On connaît, dans la musique
savante occidentale, d'autres exemples aux titres moins éloquents, mais dont le
caractère général ne laisse planer aucun doute sur l'utilité du chromatisme
descendant. En voici deux, dont le chromatisme apparaît en rouge :
Chopin, valse
n°7 en do# mineur :

Rachmaninoff, Prélude
en do# mineur :

Ce musème connote
donc à la fois l'esprit de la fête foraine (incluant le manège et l'enfance) et
une atmosphère sombre. Un exemple réunissant ces deux éléments, et donc
comparable en tout point à ce musème, est le thème exécuté à l'orgue de
barbarie dans le film La cité des enfants perdus. Le personnage incarné
par Jean-Claude Dreyfus, ancien professionnel du cirque, assis dans la pénombre
près d'un canal aux eaux fumantes, interprète la mélodie suivante pendant que
s'opère sous ses yeux une série d'assassinats :


Les mélodies jouées par
l'accordéon sont tantôt au premier plan (comme dans l'introduction), tantôt en
contre-chant (pendant le refrain). Dans les deux cas, la musique renvoie à des
significations particulières. Voici, par exemple, deux éléments probants :
L'accordéon est un
instrument aisément classable dans les synecdotes de genre : son timbre,
associé au rythme de valse, implique automatiquement l'idée de musette, de bal
populaire, et de la France
d'entre deux guerres. Il faut dire que parmi les morceaux les plus populaires
de cette époque, nombreux sont ceux dont le rythme est à trois temps, et dont
l'accordéon fait parti intégrante de l'arrangement. Ces mêmes morceaux sont
pour la plupart souvent repris à l'accordéon seul. On pense entre autre à Mon
amant de Saint-Jean, La java bleu, La romance de Paris, ou
encore La valse brune.
Mus. 5 « la plainte »

L'intervalle de sixte
mineure, indiqué par un trait rouge dans le musème, est souvent utilisé
dans les musiques tintées d'un climat nostalgique et triste. Ici, deux exemples
: Manha do carnaval et Love story qui sont des morceaux qui
entrent parfaitement dans cette catégorie.
Manha do carnaval :
Love story Francis Lai (1970):
La guitare double l'orgue
de barbarie, et comme lui, a donc un rôle d'accompagnement, s'inscrivant elle
aussi dans le rythme de valse selon la même structure (basse/accord/accord).
Outre l'idée que la guitare
est souvent associée à l'accompagnement des chansons, par son côté pratique
(instrument polyphonique léger et transportable) mais aussi parce qu'elle est
souvent rattachée à l'image du vagabond allant déclamer ses chansons de village
en village, son timbre (ici acoustique) implique plusieurs connotations :
mélangé avec celui des violons, il peut évoquer le timbre d'un clavecin, et par
là même, renforce l'image châtelaine du refrain, mais surtout, le son
acoustique de la guitare implique une atmosphère intimiste propice à la bonne
déclamation des paroles. Les concerts unplugged qui ont fleuri dans les
années 90 soulignent presque toujours l'atmosphère intimiste par l'apport de la
guitare acoustique.

La basse marque toujours le
premier temps de la mesure (le temps fort). De plus, il s'agit toujours de la
note fondamentale de l'accord (il n'y a donc pas d'accords renversés). Ces deux
procédés réunis impliquent une certaine lourdeur et met donc en relief le
ressort dramatique opéré par les instruments au dessus d'elle.
Il faut rendre compte de
certains éléments esthétiques prépondérants du morceau que nous n'avons pas
transcrit et extrait sous forme de musèmes. Ces éléments sont au nombre
de 3 :
A la reprise du couplet,
une mesure supplémentaire vient s'insérer avant le refrain, supposant un
couplet à 9 mesures au lieu de 8. Ce chiffre impaire, peu courant dans les
carrures de musique de variété implique chez l'auditeur un malaise, du fait de
la « bancalité » de la musique.
A la fin, le chanteur
reprend le thème du refrain en sifflant. Cette technique permet de faire
retenir de façon prégnante une mélodie à
l'auditeur. On la trouve par exemple dans les chanson La pluie de
Jean-Jacques Goldman, Smile de Michael Jackson ou encore Tomber d'en
haut de Jacques Higelin.
Le dernier accord,
« C# add9 », se compose des notes suivantes : Do#, Sol#, Ré#. Il
s'agit donc d'un accord de Do# sans tierce. L'absence de tierce implique que
cette accord à une sonorité ouverte et donc pas tout à fait conclusive. Cela
implique également l'idée d'un son désincarné, sans corps, qui colle
parfaitement à l'atmosphère sombre de la chanson, et au caractère désabusé du
texte.
Le contexte sociopolitique
En décembre 1984, plus de 27 tonnes de gazes mortels fuirent
d’un réservoir de stockage se propageant
au le coeur de la ville de Bhopal, qui tua près de 8.000 personnes.¶
¶Depuis lors, les plus de 20.000 décès ont été
attribuées au désastre.¶
¶Les survivants et leurs enfants
continuent à souffrir. Différents troubles de la santé ont été constaté :
des cancers, la tuberculose, des malformations à la naissance et des fièvres
chroniques touchent la population. ¶Les études multiples ont trouvé du mercure, du
nickel et d'autres toxines dans les eaux souterraines locales et un niveau
dangereux de toxine dans le lait des seins des femmes qui vivent près de la
zone d'usine.¶



Bhopal 1984 Sahel Seveso 1976
La
catastrophe de Seveso en 1976 , dut à l’explosion d’un réacteur chimique de
l’usine IGMERA, industrie pharmaceutique. La température s'élèva en effet
jusqu’à 220° provoquant la production de dioxine. Un nuage toxique de dioxine
se répandit sur la ville provoquant la mort de nombreux animaux et l'apparition
de lésions cutanées graves.
Le Sahel est principalement recouvert par la steppe
et la savane. Il reçoit 150 à 500 mm de précipitations par
an, principalement pendant la mousson.
Si les conditions climatiques sont particulièrement difficiles, la vie
quotidienne et l’économie sont également soumises par une politique
chaotique.
Conclusion
Dans la première partie
nous avons effectué une présentation générale du morceaux, puis, dans la
deuxième partie, une analyse détaillée par l'apport de musemes, puis
enfin, la description du texte et ses liens avec la musique.
On retiendra plusieurs
éléments :
–
L'atmosphère sombre du
morceau est opérée par un chromatisme descendant.
–
La déclamation et la mise
en relief du texte impliquée par le ton monocorde et le rythme de la mélodie du
couplet, ainsi que le timbre intimiste de l'accompagnement à la guitare.
–
Des éléments de nostalgie,
avec l'apport de l'accordéon, rappelant le passé, et l'utilisation de
l'intervalle de sixte mineur.
–
Le caractère aigri et
désabusé du morceau, mis en évidence notamment par le timbre de la voix du
chanteur.
–
Des éléments musicaux liés
à l'image du château par l'utilisation des cordes et de la guitare qui peut,
dans le refrain, être assimilée au son d'un clavecin, d'une part, et liés à
l'image de la fête foraine par l'utilisation de l'orgue de barbarie d'autre
part.
–
Le rythme de valse provoque
une anaphone Kinesthésique, quelque chose de cyclique, de tournant.
–
Les constates entre le
couplet et le refrain
Ces éléments rassemblés
détermine la nature du morceau : une chanson engagée mais emprunte de
désenchantement, et qui met en relief les paroles, pamphlet contre les grands
dirigeants et constat amère sur la condition des enfants dans le monde.
Liste des
références musicales
50 ans d’accordéon – 109 grand succès, EPM
2000
Aznavour Charles, Comme ils disent, 1973
Badalamenti Angelo, La cité des enfants perdus
Bonfa Louis, Manaha do carnaval
Chant de marins, Logouvy de la mer
Chopin Frédéric, Valse en do#m op.64 n°2
Disneyland Paris - Fantasyland - Le Carrousel De Lancelot Music Loop
Revaux, J. et G. Thibaut, Comme d’habitude [interprété par Claude François]
Grieg, La
marche des nains de la suite lyrique
Guns n’roses, You could be mine
Jackson Michael, They dont care about us, 1995
Kuti Fela,
Government Chicken Boy, Universal
Lai Francis,
Love story
Mozart Wolfgang Amadeus, Fantaisie en ré mineur
Mozart Wolfgang Amadeus, Sonate en la mineur K. 310
Orgue de barbarie des
frères Limonaire, La ronde des chevaux de
bois
Carrara Emile, Mon amant de Saint Jean, 1945 [interprété
par Edite Piaf]
Rachmaninov Sergei, Prélude en do#m op.3 n°2
Rodrigues Amália, Gaivota, Voix du Portugal, Actes Sud
Strauss Richard, Ainsi parlait Zarathoustra
Tchaïkovsky Piotr, Seul qui connaît la tristesse
Tiersen Yann, La valse d’amélie, 2001
Williams John, Harry Potter, 2001
Zimmer Hans, Gladiator, 2000
 M
M![]()

















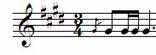
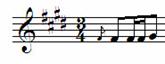


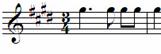






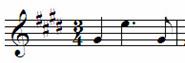



 Mozart
Fantaisie en ré mineur K.V.397
Mozart
Fantaisie en ré mineur K.V.397

























